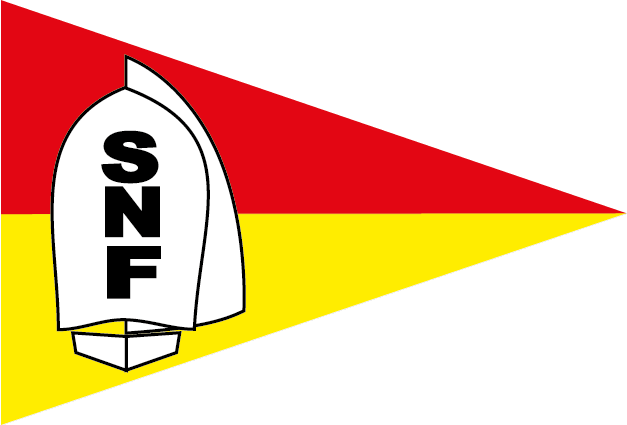PREMIÈRE CHRONIQUE : EN CE TEMPS LA, AUX SNF par Georges Aribaud 1961 : LES PREMIERS PAS
Frustré comme nous tous par l’impossibilité de naviguer aux vents incertains de La Seine qui me nargue de mes fenêtres, les souvenirs me reviennent de tous ces moments heureux qui j’ai vécu aux SNF.
Faute, de plus , de ne rien pouvoir organiser pour les 60 ans du club, je me suis dit, pourquoi ne pas partager ces souvenirs avec les membres du club ? Nous sommes riches de notre passé, le club d’aujourd’hui est aussi le fruit de son histoire.
Peut-être est-ce présomptueux de penser que cette histoire intéresse. Mais après tout, comme pour les caricatures, si on n’est pas intéressé, on n’est pas obligé d’en prendre connaissance.
Il ne s’agit pas ici de faire un historique du club, mais plutôt de le raconter les événements et les personnalités au gré de mes souvenirs.
Ma première inscription au SNF, c’est un samedi après midi du printemps 1961, j’ai 14 ans. C’est le trésorier du club, Guy Lagrange qui m’accueille. C’est un jour sans vent – ça arrivait parfois à cette époque – et en plus il bruine. Alors Guy sort une canadienne*, blanche à l’extérieur, rouge à l’intérieur, et nous voilà partis à la pagaie jusqu’au virage amont ; j’adore ça.
Le lendemain Dimanche, j’y reviens et là Guy sort son bateau c’est un « Shearwater » bleu – un catamaran – sur lequel je reçois mes premiers cours de voile.
En, 1961 le club a 1 an, pour autant, l’activité nautique à La Frette, existait avant.
Paul Fischesser le président fondateur, était l’heureux propriétaire d’un « Chat », pas l’animal, non le quillard. Comme d’autres Frettois, il naviguait sur le Seine, qu’il descendait aux beaux jours pour naviguer au Havre, à la Société Nautique du Havre dont il était membre.
Adjoint de la ville, il crée l’activité nautique au sein de l’Etoile Sportive Frettoise qui regroupe toutes les activités sportives de la ville. Il achète les bateaux, aménage la baignade en quai, fait construire la rampe d’accès au quai, installe un treuil et une rampe de mise à l’eau, etc.
Continuant sur sa lancée il veut installer une grue : celle du ponton en ciment. Le bureau de l’Etoile Sportive Frettoise qui décide des investissements conteste cet achat. L’un des membres en vient même, sournoisement, à soupçonner que cette grue n’a d’autres intérêt que de servir à gruter le Chat du président !
Paul Fischesser face à cette attaque aussi perfide qu’injuste : quitte l’Etoile Sportive Frettoise et crée les SNF.
C’est ainsi que cette grue que nous ignorons tous aujourd’hui marque l’acte de création des SNF, elle est le symbole de notre émancipation !
Deuxième chronique : EN CE TEMPS LA AUX SNF : PLANTONS LE DÉCOR : LA FLOTTE HISTORIQUE
Dans les années soixante, le quai est plus étroit et bien moins long aujourd’hui ; il s’arrête pratiquement à la hauteur du 91 quai de Seine.
La flotte du club, est composée, outre de la canadienne citée plus haut, de cinq Sharpies – série olympique en solitaire avant le Finn – et deux Snipes. Tous en bois plein, à coque rouge et pont blanc, voiles en coton, mat et baumes en bois plein aussi, dérives en acier.
La mise à l’eau se situe exactement là où nous mettons à l’eau les VO aujourd’hui. Il n’y a pas de grue, c’est avec un treuil à main sur lequel s’enroule le câble que nous attachons au berre de mise à l’eau qui glisse sur deux rails inclinés.
Lourds à terre, sur l’eau se sont des bateaux agréables, en particulier le Sharpie, avec ses 9 m² de voile très lattée, ses lignes tendues, à l’étrave si fine qui fend l’eau sans pratiquement laisser de sillage.
Avant l’agrandissement du quai, il y a cet endroit une passerelle en béton qui délimite un bassin de nage. Au bout de cette passerelle, un ponton flottant, en bois, très bas sur l’eau prévu pour les skiffs. Les dispositifs des dames de nages passaient au-dessus ce qui facilitait l’embarquement sur ces engins étroits et instables. En effet, si notre club s’appelle Sports Nautiques Frettois, c’est parce que Paul Fischesser l’avait conçu ouvert à tous les sports nautiques, aviron compris. Nous avons à disposition trois skiffs dont celui qui sert aujourd’hui de décoration au Club-House.
En plus des bateaux du Club, il y a les bateaux des propriétaires, des dériveurs, des quillards, un canot à moteur en acajou.
La flotte est très disparate ! il y a quelques Nordets, et Vauriens, un Zef, un ou deux Caneton, un Plongeon, (je crois que c’est celui de Robert Legrand lorsqu’il s’est inscrit pour la première fois au club) un kayac avec dérives latérales et voiles, et bien d’autres embarcations plus ou moins identifiées. Ce sont des engins en bois plein, en contreplaqué, en bois moulé, en alu, en toile. Un certain nombre de ces embarcations sont construites par leur propriétaire dans leur garage.
Si tous ne maîtrisaient pas trop leur engins par vents forts, tous savaient bricoler et l’imagination allait bon train ! Ainsi ce plombier de Cormeilles qui trouvant son Moth alu trop court, l’allonge de 50 cm avec une belle poupe arrondie. Tel autre, propriétaire d’un Vaurien trouve pénible d’être assis sur le franc bord, de travers à la trajectoire du bateau. Il s’installe un dossier pour s’assoir au fond face à la proue avec un pédalier pour commander le safran.
Les quillards sont amarrés à des corps morts alignés sur deux rangs en aval du quai. Il y a le Chat du président évidemment, une « Aile », le « Niken » l’habitable appartenant à monsieur Lucet vice-président. Parfois nous amarrons aussi les bateaux du club pour éviter de les remonter ; il faut les surveiller sinon avec une semaine de pluie nous risquons de le retrouver entre deux eaux !
Pour l’hivernage et l’entretien, nous disposons de tout l’espace du terrain que nous partageons aujourd’hui avec au fond, du hangar à bateau qui occupe toute la largeur du terrain.
Un club évidemment ce sont des infrastructures et du matériel, mais c’est aussi et surtout un lieu social où les gens se rencontrent et partagent des activités.
Les activités ne manquent pas et les individualités non plus.
CHRONIQUE n°3 EN CE TEMPS LA AUX SNF : INVENTIONS ET DÉCOUVERTES
En revisitant le passé comme ça me viennent les vers d’Aragon.
« Que s’est-il passé ?
Rien, presque rien.
La vie,
Et nous sommes vieux. »
Après ce coup de spleen, revenons à notre affaire.
Tous les weekends lors des beaux jours, du samedi matin au dimanche, il y a du monde qui vient au club, bricoler, bavarder, canoter. Par exemple le plombier que j’évoque plus haut ne vient que le samedi matin.
Paul Fischesser évidemment est très présent le samedi comme le dimanche. Pour naviguer bien sûr mais plus souvent encore pour bricoler les bateaux et les installations. Sa femme aussi vient de temps à autre. Autant il est grand, autant elle est petite. Il est de l’Est, elle est du Sud avec un accent chantant. Deux personnalités bien différentes.
Bavardant volontiers, elle me raconte sa surprise de jeune mariée voyant son mari descendre du grenier de vieux bouts de bois. Elle lui demande : « Mais mon ami, qu’allez-vous faire avec ce bois ? Et lui de répondre ; « Mais ma mie, c’est pour faire notre salle à manger », et voyez-vous Georges : ce bois, c’est notre salle à manger aujourd’hui !
Paul Fischesser est effectivement inventif, et bricoleur. Montant des systèmes de sécurité anti-intrusion miniaturisés, il conçoit et fabrique les éléments des systèmes qu’il installe.
Son talent est largement exploité au club sur les bateaux comme pour les aménagements, sur le quai comme dans le hangar.
Une fois cependant son inventivité l’entraîne sur une voie …improbable.
Décidant de moderniser la mise à l’eau, PF se procure les poutres et les plaques en acier nécessaires.
Je participe à la construction de ce plan incliné et à cette occasion je découvre :
1 – que lorsqu’un foret bloque dans l’acier, c’est celui qui tient la perceuse qui tourne autour du foret !
2 – que lorsque trois ou quatre personnes s’activent pour faire quelque chose, six ou huit autres, les mains dans les poches commentent le travail et donnent des conseils ! Aujourd’hui c’est différent.*
Une fois ce plan incliné construit, il s’agit de le mettre en place.
Le président imagine le dispositif et la manipulation pour ce faire.
Il construit deux chèvres qu’il relie par une poutre au centre de laquelle il installe un palan. Son projet est de faire rouler l’une des chèvres sur la passerelle en béton qui s’avance dans la Seine et de poser l’autre sur un ponton flottant qu’il construit à cette occasion et de tirer tout le dispositif avec un autre palan installé au bout de la passerelle.
Le plan incliné en acier doit peser une bonne tonne sinon plus. Nous sommes plusieurs à douter que le dispositif puisse fonctionner.
Mais à cette époque, entre ce que le Président décide et ce qui doit être fait, comme aujourd’hui somme toute, la marge n’est pas énorme !
*propos à prendre au deuxième , troisième ou quatrième degré, note d’un lecteur.
EN CE TEMPS LA AUX SNF CHRONIQUE N°4: : GODILLE , CORPS MORTS ET TRAVAIL A LA CHAÎNE
Tous les quillards restent à l’eau tout au long de la saison amarrés, aux corps morts. Nous devons prendre une barque pour aller les chercher. La barque dont nous nous servons est amarrée au ponton près de la grue. Heureuse époque où il suffisait de l’attacher sans aucune sécurité ! Personne n’aurait eu l’idée de l’emprunter.
Au même endroit est aussi amarrée la plate du propriétaire de la grande maison en meulière en face du club. Il travaille à la station d’épuration d’Achères, tous les jours il traverse la Seine à la rame avec son vélo.
L’un des premiers apprentissages au club c’est le maniement de cette barque, à la godille ! Il n’est pas question de se prétendre marin, ni d’eau douce ni d’eau salée, sans savoir godiller d’un geste ample et assuré en regardant vers la proue. Ce savoir-faire distingue irrémédiablement le pro, de l’amateur.
Pour les régates évidemment nous équipons cette barque d’un moteur, le plus souvent prêté par un propriétaire en attendant que le Club s’enrichisse. Parmi ces moteurs un Seagull et un Goïot, qui ont la particularité d’avoir un volant de lancement sans enrouleur automatique. Autrement dit, pour les mettre en route, il faut enrouler la corde autour du volant, tirer un bon coup et espérer que ça démarre ce qui n’est pas garanti.
Autre charme du dispositif, s’il y a des passagers, à tous les coups ils ont droit à la corde dans la figure !
L’installation des corps-morts est une rude affaire. Ils sont faits d’une dalle en béton d’un mètre de carré, au centre de laquelle est frappée une chaine de 6 à 7 mètres, attachée à un bidon d’acier de 50 litres. Lorsqu’on charge ce matériel avec la grue, la barque s’enfonce dangereusement, il faut en outre 2 hommes à bord pour amener le tout à l’endroit idoine.
La barque est surchargée, au ras de l’eau. Evidemment c’est en début de saison, le courant est encore fort : les remous des péniches ajoutent au charme de l’opération !
Comme à la guerre, ce sont les plus jeunes qui sont au front, les plus âgés restent à quai, donnent des conseils et critiquent la manœuvre. Arrivé à l’endroit du mouillage, tandis que l’un, maintient la barque à l’endroit voulu, l’autre met à l’eau le bidon, la chaîne, et fait glisser la dalle de béton. Soulagée la barque se soulève d’un coup en tanguant : il vaut mieux s’accrocher. Mais ce n’est pas fini. Quoique lourde, la dalle ne tombe pas à la verticale, elle plane un peu. Trop près de la berges les bateaux risquent de s’échouer, trop loin, une péniche pourrait les emporter. Il faut donc reprendre le bidon, accrocher la chaîne, et debout à l’arrière de la barque, faire décoller la dalle du fond pendant que la barque s’enfonce et que les péniches nous secouent, et à la rame toujours l’amener au plus près de l’endroit souhaité.
Pour 4 bateaux amarrés en ligne : il faut cinq corps-morts. Leur mise en place nous occupe.
Pour l’hivernage, il faut relever ces corps-morts qui autrement seraient emportés par les crues et les arbres flottants. Envasées depuis sept mois, les dalles font ventouse : elles sont quasiment impossibles à bouger : surtout avec la barque dont nous disposons. Mais aux SNF si nous n’avons pas de moyens, nous avons des idées ! Robert Jolly je crois, propose de sortir les dalles à l’aide d’une voiture ! Paul Fichesser a des doutes ! On attache les chaines à une corde que nous fixons à l’attelage d’une Peugeot 403 ; le moteur ronfle, la chaîne se tend. Rien, pas plus la voiture que la dalle, ne bouge. En fin de compte nous attachons les chaines à la berge nous on les retrouverons au printemps
CHRONIQUE n° 5 où les SNF découvrent la régate les régatiers et leurs errements avant un retour au fair play
Bien qu’au départ les fondateurs du club soient plus tournés vers le canotage que la compétition, des régates seront assez vite organisées.
Les bouées sont faites d’un bois plat de 2 mètres. Au tiers inférieur il traverse un bâti qui supporte 4 bidons d’huile moteur. En haut un fanion, sous l’eau un contre poids, une corde et un poids morts qui sert d’ancrage. un vrai radeau!
C’est efficace, visible, économique. Un seul incident à signaler, lors d’une régate avec vent du nord soutenu, nous chercherons médusés ,la bouée aval jusqu’au passeur d’Herblay. Sans doute a-t-elle coulé, à moins qu’une péniche l’ait emportée !
La ligne de départ se situe là où elle est aujourd’hui.
Le comité de courses dispose d’un petit canon de sécurité qui fonctionne avec une cartouche de 12 (à blanc !). C’est plus classe que le klaxon qui le remplacera. Evidemment les temps compensés se calculent sans ordinateur ni calculettes avec des tables . La maîtrise du calcul mental s’impose. Cependant c’est quand même pénible. Alors, au début, le calcul se fait sur le total du temps mis pour faire l’ensemble des manches, en additionnant : du coup, toutes les manches comptent.
La mode du dériveur bat alors son plein : le club s’agrandit. La longueur du quai fait plus que doubler ! De nouvelles séries apparaissent et se développent avec succès après le vaurien et le 420, comme le 470 et le Ponant dont une flotte se constitue à La Frette. La régate aussi devient bien plus fréquente : entre les régates dites d’entrainement et les interclubs ; pratiquement nous régatons tous les WE et fréquemment avec 20, 25 bateaux sur l’eau.
Avec la régate apparaît une espèce nouvelle au club : le régatier. Le régatier se distingue souvent par une forme de pathologie mentale, qui transforme un homme, ou une femme, apparemment équilibré en fou furieux sur l’eau lorsque qu’il estime – à tort ou à raison – qu’un concurrent lui fait tort !
Par exemple, un des premiers membres du club se construit un Sharpie en contreplaqué, participe à une régate. Ses parents l’observent de loin à la jumelle (ils sont en haut de la cote à Boivin c’est à dire à trois kilomètres!). Lors de la remise des prix, ces fameux parents qui n’y connaissent rien, lui affirment qu’il a gagné la régate. Du coup, Il fait une scène pas possible au comité, au président, à tout le monde, puis … disparaît à jamais du club.
Autre exemple. J’ai le mauvais goût de gagner une régate devant le fils du président du comité de course : il me disqualifie pour non-port du gilet de sauvetage. Quelqu’un de bien intentionné lui fait remarquer que le président n’en porte pas non plus, et aussi sec le malheureux Paul Fischesser est disqualifié.
En régate à l’extérieur dans la série des Ponants, nous rencontrions souvent un jeune couple, charmant – à terre – qui tente de garder des relations courtoises à bord en se vouvoyant. Aussi sur l’eau, par ces temps de pétole si fréquents sur la Seine, nous entendions des : « Mais, p… de m.. vous l’accrochez ce tangon espèce de c …. Vous êtes abrutie ou quoi ? Bâbord, à gauche j’ai dit … ) et caetera. Nous l’avons même vu fourrager un jour avec le tangon du spi dans le caisson avant du bateau où sa femme s’était réfugiée, pour l’en faire sortir !
Heureusement, ce régatier primitif , modèle Dr Jekkyl et Mr Hyde, a quasiment disparu aujourd’hui, où lors des passages de bouées entre bateaux engagés, ce que nous entendons le plus souvent murmurer avec une exquise courtoisie, c’est :
« Mais non tu ne me dérange pas, passe donc devant. »
« Aucun problème, d’ailleurs j’adore la couleur de ton tableau arrière ».
» Auriez vous l »extrême obligeance de bien vouloir m’accorder la priorité, s’il vous plait ? » étant considérée comme une formule à la limite du mauvais goût
Autant de dialogues qui nous rappellent le bonheur de partager ensemble un sport de loisir et de détente que nous aimons tous.
CHRONIQUE N°6: Les inventeurs dans leurs œuvres
Outre sa constante bonne humeur et son ineffable courtoisie, le régatier d’alors se distingue par des recherches permanentes et quasi frénétiques d’accastillage.
Il déplace les taquets coinceurs, les points de tire du foc. Il invente tout une série de circuits qui permettent en navigant de régler au près avec des renvois, sur un bord, comme sur l’autre : la tension du guidant, la tension de la voile sur la bôme, la position de l’étambrai, la tension du halebas, différents circuits pour le spi, adapté à différentes forces de vents, etc.
Bref le cockpit d’un 470 d’alors peut être pratiquement aussi complexe que celui d’un Imoca d’aujourd’hui !
Avant toute régate, il s’interroge sur le jeu de lattes qu’il doit utiliser, la façon dont il doit caler l’étambrai, le circuit de foc qu’il doit armer : vent faible, moyen, fort ? Cette obsession lui fait oublier parfois l’essentiel.
Ainsi, au vent arrière, à la même hauteur que deux frères gravement atteints de cette « acastillomanie » il suffit de leur faire remarquer que leur spi ne porte pas très bien parce qu’ils n’utilisent pas le bon circuit, pour qu’ils s’énervent, s’agitent en tous sens pour en changer et perdent les 10 ou 20 mètres qui permettent de les dépasser. (Ce qui n’arrange en rien leur humeur !)
Il faut dire aussi que l’accastillage évolue.
Au début pour border le foc, nous disposons : de presque rien c’est à dire simple filoir, puis d’un winch monté sur une tourelle au-dessus du puits de dérive, puis de poulies winchs. Pour la grand-voile : c’est le même dispositif utilisé que celui d’ aujourd’hui sur les Lasers. Le palan frappé en bout de bôme. Le renvoi dans le cockpit se fait par une poulie accrochée à un croissant en bronze sur la bôme. (Entre la bôme en bois plein et dur, et le croissant, le coup de bôme n’a rien d’une plaisanterie !), puis arrivent les barres d’écoute.
Les gréements pour tenir ces mats en bois pleins, sont plus complexes aussi. Le Chat du président a non seulement haubans et barres de flèches, mais aussi bas haubans, bastaques et pataras.
L’entretien des bateaux occupe beaucoup de temps. Ils sont en bois, il faut les poncer, les peindre et les revernir tous les ans. Parce qu’en plus, ils sont soignés associant peinture et vernis pour leur donner fière apparence. Ainsi, un Vaurien le plus souvent c’est une coque peinte en blanc à l’extérieur, vernie à l’intérieur. L’entretenir c’est régulièrement reprendre peinture et vernis.
Les propriétaires sont d’autant plus soigneux, que ces engins sont chers. Dans ces années-là ceux qui achètent un dériveur neuf, ce sont des médecins, des petits entrepreneurs, des notables. Pour ceux, nombreux, qui veulent naviguer sans nécessairement avoir les moyens d’investir dans un bateau neuf, il y a la construction amateur.
Ils achètent les plans à l’architecte et construisent leur bateau chez eux. Des séries comme le Sharpie, le Caneton, la Yole OK et bien d’autres se développent en partie par ce moyen. Certains clubs organisent même des chantiers de construction amateur. C’est pour cette raison d’ailleurs que bien des séries alors sont à bouchains vifs : plier un bois plein ou un contreplaqué dans une dimension ça va, dans deux c’est autre chose.
Il faut voir en début de saison ce nouvel adhérent qui se présente avec sa création, qui la fait admirer par les membres présents, à juste tire d’ailleurs ce sont souvent des embarcations très bien faites. Puis il la met à l’eau avec d’infinies précautions, navigue un peu, puis la sort et la nettoie soigneusement. Il faut dire aussi que dans les années soixante, la Seine est vraiment sale. Lorsqu’on y trempe un doigt on n’en voit pas l’ongle ! Et lorsqu’on sort les bateaux, la ligne de flottaison est graisseuse avec des dépôts d’huile et de gasoil : chaque fois nous devons la savonner et la rincer.
Chronique n°7 les réparations aux temps jadis avec un ancien caphornier
En ce temps-là aux SNF : l’entretien hivernal des bateaux
Pour l’entretien des bateaux nous disposons d’un grand hangar qui fait toute la largeur du terrain sur lequel se situe le club-house aujourd’hui. En période d’hivernage l’activité du club se replie dans ce hanhar où les uns et les autres viennent entretenir leur bateau, ou tout simplement bavarder.
Le hangar est sombre, en terre battue, mal éclairé d’un côté par des plaques translucides du toit et quelques rares ampoules.
Pour le chauffer, un peu – parce que pratiquement tous les WE il y a du monde – un poêle à fioul d’atelier. C’est une bassine en zinc couverte avec une cheminée à ailettes d’un mètre cinquante environ. On allume la surface du fioul, la flamme s’engouffre dans la cheminée qui rougit plus ou moins.
Autour du poêle les discussions s’animent sur la voile et les sorties en mer de l’été et les régates de la saison ; plus souvent encore sur la vie professionnelle, les expertises des uns et des autres, les anecdotes. Il y a comme ça autour du poêle un représentant en chaussure, un pharmacien, un représentant en vins du Rocher, un architecte, un imprimeur, un plombier, un courtier en bourse, monsieur Fischesser évidemment, etc.
En plus de bavarder bien sûr, il y a le travail sur les bateaux et les installations. Paul Fischesser entre autres talents réalise des épissures sur câbles ! Aujourd’hui pour nos haubans, nous enfilons un manchon et d’un coup de marteau ou de pince, nous en assurons la liaison. Ce dispositif n’existe pas, au club en tout cas. Pour fixer un câble, il faut faire des épissures. Déjà à trois ou 4 torons sur un bout ce n’est pas évident, mais sur un câble avec 10 ou 20 fils : c’est une tout autre histoire.
Parmi ces adhérents, le Commandant Garroche. Commandant de la marine marchande, il vient de prendre sa retraite à La Frette où il a fait construire une maison rue de la Gare. Il se procure un petit canot en bois, avec un moteur Bernard intérieur refroidi à l’eau pompée sous la flottaison et rejetée au-dessus.
Tout le fond sous le moteur est à refaire. Je suis en vacances et je l’y aide. Nous mettons les bois des clins à tremper dans la Seine, puis nous les ajustons sur les membrures, avant d’y percer des avant trous et de les riveter. Pour ce faire je suis d’un côté de la coque, j’introduis le rivet. De l’autre côté, le commandant le « matte » pendant que j’applique une contre masse.
Tout en travaillant il me parle de sa vie de marin. Il était cap-hornier, à savoir que débutant, il avait passé le cap Horn à la voile sur un bateau commercial ! (J’ai lu que le dernier transport commercial à la voile date de 1957, c’était un vraquier qui reliait le Chili à l’Europe !).
A la suite de l’agrandissement du quai, les nombre des adhérents fait plus que doubler. Le quai est plein d’un bout à l’autre, il faut même couvrir les piscines pour aligner une bonne dizaine de bateaux supplémentaire, ce sont les Ponants qu’on y place parce qu’on les met à l’eau avec la grue.
Le surcroit d’activité qui découle de cet apport d’adhérents incite le président à embaucher un employé à temps plein : le père Mathieu. Guy Lagrange, le trésorier s’oppose à cette décision, démissionne et à mon grand regret quitte le club.
*Guy passait une fois par an sur le quai depuis cette date et disait immanquablement vouloir s'acheter un Finn, on était habitué, on n'y croyait plus trop, , mais depuis deux ou 3 ans , Guy ne passe plus, le temps qui passe est sans pitié ....
N°8. En ce temps-là aux SNF: Un salarié et un éboulement
Le père Mathieu est un petit bonhomme à la casquette toujours vissée sur la tête. Il a travaillé aux usines Lambert comme beaucoup de Frettois alors.
Il habite rue Victor Hugo, dan sle vieux La Frette, non loin dela Seine ,la maison mitoyenne de celle qu’occupera plus tard Robert Legrand.
C’est un bricoleur de génie qui en quelques semaines réorganise tout le hangar, s’installant un atelier, alignant sur un plancher les armoires qui aujourd’hui encore nous servent de vestiaires, améliorant les dispositifs pour sécher les voiles (les voiles en coton lorsqu’elles prennent l’eau doivent être mises à sécher.) installant des râteliers pour les lattes (sur le sharpie il y en a 5 et la plus longue fait 1 m 20), etc…
Salarié du club, son travail est aussi monnayé auprès des propriétaires qui lui confient les travaux d’hivernage : essentiellement la peinture.
Son activité ne dure pas bien longtemps. Une nuit une coulée de boue déclenchée par une fuite d’eau dans la rue de la Gare emporte la moitié du hangar écrasant tout sur son passage.
Heureusement il n’y a personne.
Avec la moitié de hangar qui reste on rafistole tant bien que mal un semblant d’abri en attendant une reconstruction.
Parmi les adhérents, un architecte, Monsieur Blondet, dessine le projet d’un bâtiment à 2 niveaux qui occuperait toute la largeur du terrain. Un grand garage, pour l’hivernage et l’entretien, surmonté d’un club house avec terrasse ! Sans doute entre l’assurance et les finances du club ce projet, qui nous fait rêver, est-il viable.
Mais, le maire de La Frette, Monsieur Cholet a d’autres projets pour le Club. Il est en train de faire réaliser la base de loisir qui aujourd’hui porte son nom, et veut y regrouper tous les sports, le club de voile y compris.
Paul Fischesser ne l’entend pas de cette oreille !
Il faut dire qu’il a beaucoup investit dans le Club. L’agrandissement du quai, financé par lui et d’autres membres n’est sans doute pas encore remboursé.
Il refuse le transfert, et réussit, en s’opposant au Maire, à maintenir le club à son emplacement actuel.
Le Maire aussi est têtu. Il bloque notre projet de club house et profitant des subventions Malraux pour la création des « Maisons de la Jeunesse et de la Culture », fait construire le local actuel, dont il attribue la moitié au club de jeunes !
De plus, pour nous compliquer la tâche, il réhausse le terrain, ce qui oblige la construction de l’escalier que nous connaissons qui de son point de vue doit rendre le terrain impropre à l’hivernage des bateaux.
Je vois encore Paul Fischesser, la main sur le Chat, son bateau que nous venons de hisser en haut marches, rejetant sa casquette en arrière et se grattant le haut du crane d’un geste qui lui est familier, dire avec un large sourire : « Eh bien, Chollet qui croyait que ces marches nous empêcheraient de monter les bateaux ! »
Pour ma part je regrette que le club ne déménage pas à la base de loisir. Là-haut les coteaux s’éloignent de la rive, le vent y est plus régulier, la Seine plus large, nous pourrions régater sur des parcours triangulaires. Toujours lorsque nous naviguons c’est cette portion de Seine que nous visons parce que c’est là qu’il est le plus agréable de naviguer.
Chronique n° 9. En ce temps-là aux SNF : l’école de voile , première mouture, la compétition et ses dérives
Au début, il n’y a pas d’école de voile. Ce sont les propriétaires qui embarquent et « forment » les nouveaux venus.
Former c’est beaucoup dire ! Ces propriétaires sont autodidactes. Les données qui expliquent le fonctionnement d’un voilier leur sont le plus souvent totalement étrangères. Leur conception de la voile tient plus de la recette que de l’explication rationnelle. Ils apprennent par essais erreurs : ils règlent leurs bateaux un peu au hasard avec parfois des pratiques plutôt baroques, tel ce propriétaire de Vaurien qui calle son pied de mat en le posant sur une pierre ! Lorsque je lui demande pourquoi, il me répond : « C’est comme ça que ça marche le mieux. ».
Qu’est-ce qui fait qu’un bateau est ardent ou mou ? Qu’est-ce qu’une voile qui ferme ? Quelles sont les lignes d’eau dans lesquelles le bateau marche le mieux ? Comment régler la quête du mat ? Comment choisir entre un prés serré sans vitesse et plus de vitesse mais moins d’angle, le tout en fonction de sa voile plus ou moins plate ; de la force du vent et de l’orientation du courant ?
De plus évidemment les règles de courses leur sont totalement étrangères en dehors de ne pas franchir la ligne avant le départ, et la priorité tribord. Les règles d’engagement aux bouées se résument à crier plus fort que les autres qui de toutes les façons s’écartent s’ils veulent éviter un contact plus ou moins brutal.
Plus tard, la pratique de la régate, et le nombre d’élèves augmentant un certain nombre d’entre nous prennent en charge tous les samedis, avec les bateaux du club les nouveaux venus. La théorie se passent à la Mairie à coté de la salle des fêtes.
Bien vite ce système connait aussi ses limites.
Monsieur Chabot, instituteur à La Frette prend la responsabilité de l’école de voile. L’école accueille alors plus de 70 élèves, des jeunes de CM2, mais aussi des collégiens et de lycéens. Les 2 Snipes et les Charpies laissent place à 7 Vauriens baptisés des jours de la semaine, auxquels s’ajoutent une Caravelle en alu (un plan Herbulot:une galaxie).
Dans le même temps, un autre phénomène se développe, qui change fondamentalement l’ambiance des clubs de voile : des SNF comme des autres.
Avec le développement de la pratique de la voile la FFV, mets en place un outil d’évaluation de l’activité sportive des séries et des Club. C’est Monsieur Tourreau, vice-président de la FFV, président du club de Montesson (et accessoirement employé de l’EDF) qui invente un « compteur » d’activité sportive : le « bateau départ ». La notion est simple, un bateau départ, c’est un bateau qui prend le départ à une manche de régate, ou qui participe à un entrainement.
Du coup, les séries qui toutes souhaitent avoir le statut de « série nationale », basé sur le nombre de bateaux départs/an, poussent à la régate. Les membres les plus actifs du club, partent le WE régater dans les clubs qui organisent des régates de série. Plus fort encore, les clubs sélectionnent les séries admises excluant du même coup ceux qui naviguent sur autre chose. A Montesson par exemple il n’y a que les 505 et les 420 qui sont admis. : les SNF évitent de peu cet écueil.
Le résultat de cette course au bateaux départ, est que bien vite, le club devient un garage où nous venons le dimanche matin chercher le bateau que nous ramenons le soir ! Lors des WE prolongés, des régates régionales, voire nationales, regroupent les séries un peu partout en France. Au bout du compte nous connaissons et fréquentons plus les régatiers de la série, que les membres de notre club ! La vie du club s’étiole, les nouveaux venus ne trouvent plus personne pour les accueillir et les intégrer.
Un candidat à la présidence de la FFV vient de nous interroger pour savoir comment relancer l’activité.
La réponse est là : la majorité des gens pratiquent un sport de loisir, pour se faire plaisir et parmi eux une minorité pratiquent un sport de compétition. Si l’activité d’une fédération est uniquement centrée sur la compétition, l’activité loisir périclite, les clubs aussi du coup le nombre des adhérents et le poids de la fédération aussi.